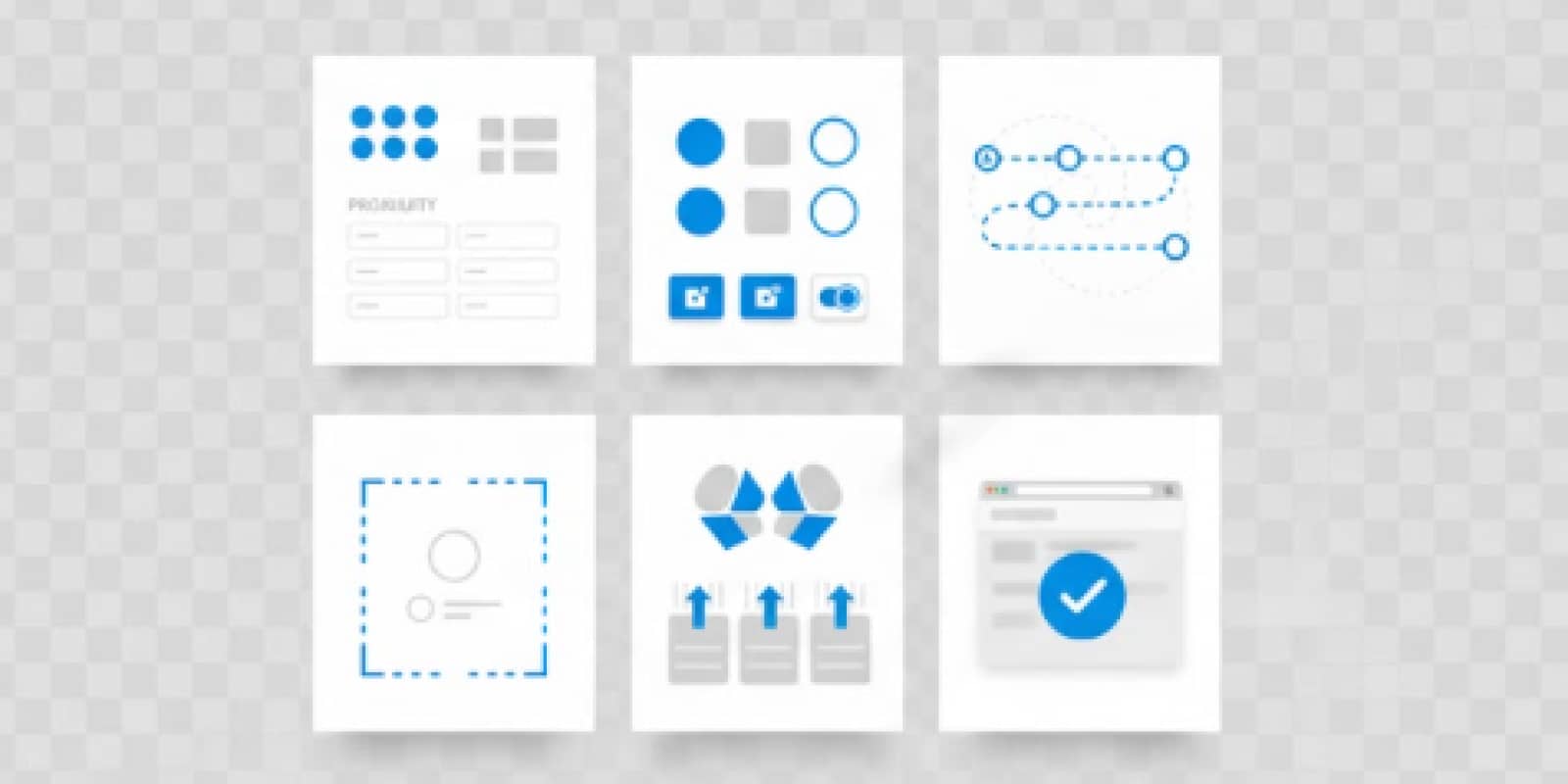Les principes de Gestalt : la psychologie au service de votre UI
La manière dont un utilisateur perçoit une interface influe directement sur sa compréhension et sa fluidité de navigation. Les principes de Gestalt apportent des clés précieuses pour organiser l’information, créer des liens visuels et renforcer la cohérence d’un design. En s’appuyant sur la psychologie de la perception, ils permettent de concevoir une UI plus intuitive, plus lisible et plus agréable à explorer.
Qu’est-ce que la psychologie de la Gestalt ?
Origines et fondements de la théorie
Née au début du XXᵉ siècle, la Gestalt est une approche psychologique qui s’intéresse à la manière dont nous organisons spontanément les informations visuelles. Ses fondateurs Wertheimer, Köhler et Koffka ont montré que notre cerveau ne perçoit pas les éléments isolément, mais comme des formes globales. Ce principe fondamental donne son nom à la théorie : “le tout est différent de la somme des parties”.
Le rôle de la perception dans la compréhension visuelle
La Gestalt explique que notre système visuel cherche en permanence à donner du sens, à créer des relations entre les formes et à simplifier ce qu’il voit. Nous regroupons, hiérarchisons et interprétons instinctivement les informations selon des schémas universels. Ces mécanismes influencent directement la façon dont un utilisateur lit une interface, identifie les éléments importants et comprend les interactions.
Pourquoi la Gestalt s’applique parfaitement à l’UI ?
Dans une interface, chaque détail compte : l’espacement, la couleur, l’alignement, la hiérarchie. Les principes de la Gestalt permettent d’organiser ces éléments pour qu’ils soient perçus naturellement et sans effort. En les intégrant dans votre design, vous facilitez la navigation, améliorez la lisibilité et renforcez la cohérence globale. La Gestalt devient ainsi un véritable guide pour concevoir des UI intuitives et centrées sur l’utilisateur.
Les grands principes de la Gestalt appliqués à l’UI Design
Principe de proximité
La proximité oriente immédiatement la lecture et la compréhension d’une interface. Lorsque des éléments sont placés les uns près des autres, l’utilisateur les perçoit comme appartenant à un même ensemble. Ce principe sert notamment à structurer un formulaire : les champs liés (identité, coordonnées, mot de passe) sont regroupés pour éviter que l’œil ne saute d’une zone à l’autre.
Dans un tableau ou une grille de cartes, la proximité permet également de créer des blocs cohérents. Si l’action associée à une carte, par exemple un bouton d’ajout ou de sauvegarde, est positionnée trop loin, l’utilisateur peut hésiter sur sa fonction. À l’inverse, lorsqu’elle est insérée à l’intérieur du bloc, le lien entre l’information et l’action devient évident. La proximité clarifie naturellement les relations entre les contenus et limite les ambiguïtés.
Principe de similarité
La similarité repose sur l’idée que des éléments visuellement semblables seront perçus comme liés. Couleur, forme, typographie ou taille créent des familles et hiérarchisent l’information. Dans une navigation, des liens qui partagent la même apparence indiquent qu’ils mènent vers un même niveau de contenu.
Ce principe devient particulièrement utile pour les CTA, un bouton primaire conserve toujours la même couleur et la même structure, ce qui évite toute hésitation sur l’action principale de la page. À l’intérieur d’un tableau de bord, utiliser des icônes similaires pour des fonctions proches (édition, duplication, suppression) aide l’utilisateur à comprendre instantanément la logique de l’outil. La similarité construit une cohérence qui rassure et accélère la prise d’information.
Principe de continuité
La continuité guide l’œil le long d’une ligne ou d’un mouvement naturel. Les utilisateurs suivent instinctivement les alignements, les courbes ou les directions visuelles. Dans une interface, ce principe est précieux pour orchestrer la lecture d’un parcours ou orienter l’utilisateur vers une zone clé.
Une mise en page en colonne, un fil conducteur graphique ou une suite d’éléments alignés crée un chemin que l’utilisateur suit sans effort. C’est ce qui rend les timelines, les listes verticales ou les sliders particulièrement intuitifs : la structure impose une direction claire. Lorsque la continuité est rompue, par exemple un élément mal aligné ou une carte légèrement décalée, la perception se trouble immédiatement, et l’interface perd en fluidité.
Principe de clôture
La clôture décrit notre tendance à compléter mentalement une forme incomplète. Notre cerveau comble spontanément les manques pour reconstituer une figure connue.
En UI, ce principe est souvent utilisé dans les illustrations simplifiées, les icônes ajourées ou certaines formes de skeleton screens. Une carte produit dont le cadre n’est pas entièrement tracé reste perçue comme une structure pleine car l’œil reconstruit les contours. Cela permet d’alléger l’interface tout en conservant une organisation claire. La clôture peut aussi soutenir la hiérarchie visuelle, une séparation légère suffit à créer des zones distinctes sans surcharger l’écran.
Principe de symétrie
La symétrie évoque l’ordre, la stabilité et la lisibilité. Une interface équilibrée paraît immédiatement plus harmonieuse, ce qui renforce la confiance de l’utilisateur.
Dans les grilles de produits, les blocs parfaitement centrés ou répartis donnent une impression de rigueur professionnelle. Une modale dont le contenu est réparti de manière symétrique se lit mieux et rassure dans les moments où l’utilisateur doit prendre une décision, comme confirmer une action sensible. La symétrie n’implique pas de rigidité, mais elle fournit un socle visuel solide sur lequel repose la compréhension.
Principe figure / fond
L’utilisateur doit pouvoir distinguer instantanément l’élément principal de son arrière-plan. Le contraste, les ombres, la couleur ou le flou aident à faire émerger une figure sur un fond.
Lorsqu’une modale apparaît, le fond s’assombrit légèrement pour recentrer l’attention. Dans une carte, le bouton ressort grâce à un contraste plus fort ou un relief discret.
Une mauvaise gestion figure/fond trouble la hiérarchie : un CTA qui se confond avec le décor passe inaperçu, de même qu’un message d’erreur noyé dans la page. Une interface performante joue en permanence sur ces contrastes pour orienter la perception.
Principe de destin commun
Le destin commun s’appuie sur le mouvement, des éléments qui se déplacent ensemble sont perçus comme liés. Ce principe est essentiel dans les micro-interactions et les animations.
Lorsqu’une liste se réorganise et que plusieurs éléments glissent simultanément vers une nouvelle position, l’utilisateur comprend qu’un classement a changé. Dans un carrousel, le déplacement conjoint des cartes crée une cohérence immédiate et laisse deviner la logique de navigation. Même un simple feedback, comme plusieurs icônes qui s’animent ensemble lors d’une sauvegarde, renforce le sentiment d’unité et améliore la compréhension des actions.
Comment utiliser les principes de Gestalt pour améliorer votre UI ?
Renforcer l’architecture de l’information
Les principes de Gestalt offrent un cadre solide pour organiser le contenu. En structurant les blocs selon la proximité, la similarité ou la continuité, on construit une architecture lisible sans avoir besoin d’ajouter des artifices visuels. Les pages complexes comme les tableaux de bord, les listings ou les formulaires étendus, gagnent en clarté lorsque l’organisation suit la perception naturelle de l’utilisateur. Le travail consiste moins à ajouter des éléments qu’à hiérarchiser ceux déjà présents, en cherchant toujours à réduire la charge mentale.
Clarifier les parcours utilisateurs
Un parcours fluide dépend avant tout de la capacité de l’utilisateur à comprendre où il est, où il va et ce qu’il peut faire ensuite. Les principes de continuité et de figure/fond jouent ici un rôle essentiel : ils guident l’œil vers les étapes clés, mettent en avant les actions prioritaires et donnent du rythme aux interfaces.
Dans un onboarding, par exemple, une structure visuelle cohérente soutient l’apprentissage et limite les décrochages. Le parcours devient plus intuitif, car l’utilisateur reconnaît les repères d’une étape à l’autre.
Construire une hiérarchie visuelle efficace
La hiérarchie repose autant sur la perception que sur la typographie ou la couleur. En exploitant la similarité, la figure/fond et la proximité, on crée des niveaux de lecture harmonieux. L’utilisateur identifie immédiatement les zones principales, les informations secondaires et les actions importantes.
Une hiérarchie bien construite évite les hésitations, les allers-retours visuels et les erreurs d’interprétation. Elle renforce également la cohérence globale, en donnant une direction claire à la mise en page.
Optimiser la lisibilité et réduire la charge cognitive
La Gestalt cherche avant tout à simplifier la perception. En appliquant ces principes, on limite les distractions, les ruptures et les surcharges. Une interface lisible ne dépend pas uniquement de la taille du texte ou du contraste, mais de la façon dont les éléments interagissent entre eux. Lorsque les relations sont claires et les blocs bien définis, l’utilisateur accède plus rapidement à l’information utile. Cette réduction de l’effort cognitif améliore l’expérience et favorise l’efficacité, en particulier dans des contextes professionnels où la rapidité de compréhension est cruciale.
Intégrer la Gestalt dans votre processus de design
Partir d’un audit
Avant toute refonte ou création, il est utile d’examiner une interface non pas sous l’angle strictement fonctionnel, mais sous celui de la perception. L’objectif est d’identifier ce qui perturbe la lecture : éléments trop proches, actions noyées dans le fond, ruptures d’alignement, groupes mal construits. Cet audit perceptif met rapidement en lumière les zones qui génèrent des hésitations ou des erreurs d’interprétation. Il sert ensuite de base pour restructurer l’interface.
Construire des maquettes en s’appuyant sur les relations visuelles
Lors de la conception, la Gestalt devient un guide pour organiser les composants. Les blocs se structurent selon la proximité, la similarité ou la continuité, ce qui permet de créer des maquettes plus logiques et immédiatement compréhensibles. Cette approche évite de multiplier les artifices visuels; séparateurs, bordures, couleurs; et favorise un design plus sobre.
Les choix esthétiques ne sont plus arbitraires, ils répondent directement à la façon dont l’utilisateur perçoit le contenu.
Aligner les équipes autour d’un langage commun
La Gestalt facilite la communication entre UX, UI, développeurs et même clients. Parler de proximité, de hiérarchie ou de destin commun donne un cadre partagé pour expliquer les décisions de design. Plutôt que de discuter “goûts personnels”, les échanges se fondent sur des mécanismes perceptifs universels. Cela accélère les validations et aide à maintenir une cohérence forte à travers l’ensemble du produit.
Tester l’interface avec un regard perceptif
Les tests utilisateurs ne se limitent pas à la compréhension fonctionnelle. Observer comment l’œil se déplace, quelles zones attirent l’attention et où survient la confusion permet d’ajuster la structure de l’UI. Un simple rééquilibrage de proximité ou un meilleur contraste figure/fond peut améliorer la réussite de certaines actions. S’appuyer sur ces retours garantit une interface plus intuitive, plus lisible et plus efficace.
Quand la Gestalt ouvre de nouvelles pistes pour le design d’interface
La Gestalt montre que le design d’interface dépasse largement la mise en forme, il s’inscrit dans une dynamique où l’utilisateur interprète, relie et reconstruit ce qu’il voit. En prenant en compte ces mécanismes perceptifs, l’UI devient un espace plus naturel, où la compréhension naît presque d’elle-même.
Cette perspective élargit le rôle du designer. Elle invite à imaginer des interfaces capables d’accompagner les habitudes visuelles, de jouer avec les attentes, et même d’exploiter des signaux subtils pour rendre les interactions plus fluides. Une approche qui pourrait, à terme, rapprocher l’UI d’une forme de design plus intuitive, où la perception devient un véritable moteur créatif.
Cette étape concerne aussi les décideurs de l’entreprise. L’UX researcher doit les interviewer afin de récolter des informations sur les objectifs qu’ils envisagent de réaliser et les indicateurs clés qu’ils veulent exploiter pour analyser le comportement et les besoins des utilisateurs.